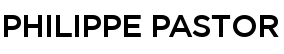Réalisée par Rodolphe Cosimi
Art Côte d’Azur, n°3559, juillet 2011, p34‐35
Artiste monégasque, Philippe Pastor a su en l’espace de quelques années s’imposer sur la scène internationale de l’art avec des œuvres chargées de sens. Engagé dans la protection de la nature, le peintre agit pour et avec l’environnement. Pigments, terre, sable, métal. La matière est omniprésente pour traduire une observation subtile du monde et… y répondre.
C’est un travail singulier que tu abordes en peinture en lien direct avec la nature. Un thème important ?
Essentiel ! Cela fait des années que je travaille avec la nature. Je n’ai pas attendu que cela devienne «à la mode» comme on dit. L’environnement est pour moi une préoccupation essentielle et c’est ce que j’aime travailler à travers ma peinture. Cela a d’abord commencé par les sculptures d’arbres calcinés et après un travail pictural assez figuratif, j’ai glissé peu à peu vers l’abstraction.
Ces arbres calcinés ont donc été ton point de départ ?
Le point de départ de mon travail en lien avec la terre. En 2003, il y a avait toute cette série d’incendies dans le Var et étant tout proche, je me sentais, bien sûr, concerné. J’utilisais alors des arbres qui avaient brûlé et je n’ai pas trouvé autre chose de plus fort pour dénoncer la négligence de l’homme face à la nature. Ils avaient été réalisés pour choquer, plus que pour être esthétiques. Je ne considère pas une œuvre pour qu’elle soit installée dans un rond‐point mais bien plus pour amener à une réflexion. C’est un travail « sans concession », comme l’a écrit Alexandra Marini. Cet aspect de la folie humaine m’intéresse, tout comme les accidents, la destruction. Ce que je veux inclure dans mon œuvre c’est une prise de conscience.
Comment s’effectue donc ce travail avec la nature ?
Les toiles actuelles sont des toiles qui sont restées longtemps en extérieur. Je mets de grandes toiles sur des bâches, à plat en pleine nature. Elles ne sont pas à même le sol, bien sûr, et il a fallu du temps pour mettre au point tout ce processus de création. Une fois posées, ces toiles sont un support pour exprimer ce que je ressens mais aussi ce que la nature a à dire.
A la vue des toiles gigantesques que tu utilises, où trouves‐tu la place nécessaire pour leur réalisation ?
J’ai la chance d’avoir une ferme dans le Var, à la Garde Freinet. C’est une ferme bordée d’un grand terrain que j’ai acheté il y a une trentaine d’années. J’habitais alors à St‐Tropez et je suis tombé presque par hasard sur ce havre de paix. C’est devenu un peu mon refuge et c’est à cet endroit que je me retrouve pour travailler, loin des vernissages ou des expositions bruyantes. C’est une belle châtaigneraie, un lieu vital où, en travaillant avec la nature, je me ressource en même temps.
Glisser de la figuration à l’abstraction a‐t‐il été chose facile ?
J’ai en effet glissé de la figuration à l’abstraction progressivement. Au début, je produisais des toiles très colorées, très expressives sur lesquelles j’apposais même des mots, des phrases. Il y avait déjà une part d’abstraction dans leur agencement mais j’ai voulu m’y plonger vraiment pour découvrir autre chose. Avant de pouvoir réellement se lâcher dans l’abstraction, il faut du temps. C’est beaucoup plus difficile que ça en a l’air.
La gestation de tes œuvres en pleine nature doit requérir beaucoup de temps ?
Oui. Pendant six à huit mois, je laisse bâches et toiles au dehors. L’eau ravine et fait son œuvre avec ce que j’y ai déposé. J’utilise un nombre important de pigments naturels, mais aussi d’éléments que je prélève dans la nature, la terre, l’eau, le feu dans la spontanéité. Parfois, le vent peut aussi y poser ce qu’il veut comme des éléments organiques de l’environnement. Les toiles s’imprègnent littéralement de la nature et j’aime composer avec elle. Au bout d’un certain temps, je récupère mes toiles et les ramène à mon atelier. C’est là que j’effectue les découpes qui me semblent justes, les parties de toiles qui m’intéressent. Je cadre ce qui me semble tenir et je retends les châssis.
Tu laisses donc la nature maîtriser une part de l’œuvre ?
Au départ, en effet, je ne maîtrisais pas les éléments. Il y avait toujours des choses nouvelles que je découvrais, qui apparaissaient. A force de travailler comme cela, je connais maintenant un peu et par avance ce qui va se produire sur la toile en termes d’effets, de rendus, bref, ce qui va se faire sur le support. Il y a une part de non maîtrisable qui me plaît. Ce qui me pousse à faire toujours autre chose est cette recherche d’aller vers l’inconnu.
Les possibilités sont‐elles infinies ?
Oui car il y a un dialogue avec la nature et nous avons tant de choses à dire. Et puis la nature est toujours en mouvement. J’y combine mes couleurs, mes matières, des minéraux, des végétaux, je fais ma cuisine et je laisse agir mon instinct. Chaque toile a sa propre vie et reste une trace.
Lorsque tu parles de travail instinctif, tu parles de sensations ressenties à un moment précis ?
J’essaie d’être au plus près des choses en les ressentant le plus possible. Mais c’est aussi une somme de recherches qui me permet de travailler comme je le fais en pleine nature. Il suffit de voir tout ce que j’ai pu accumuler comme dessins d’approches, comme travaux préparatoires dans l’atelier… Que ce soit sur papiers, sur des toiles collées, sur des morceaux de toiles, tous ces travaux sont des essais. De leurs résultats dépend ce que je décide de faire ou de développer ensuite. Il y a aussi un grand nombre de dessins que je garde depuis très longtemps.
Ton action de peinture est profondément ancrée à l’humain et à son aveuglement sur une réalité qui le rattrape.
L’homme est toujours lié à la nature et il en perd malheureusement les repères. Je suis vraiment sensible à cela car on se rend compte aujourd’hui de ce que l’homme détruit, tous ces malheurs, ces bouleversements climatiques et notamment le dérèglement dans l’alternance des saisons. Ce que l’homme détruit d’un côté, il ne le reconstruit pas de l’autre. L’homme ne veut pas voir la réalité en face mais ça, c’est dans tous les domaines. C’est le message que je souhaite faire passer pour l’environnement, c’est quelque part mon engagement.
Pour cela, tu abordes des séries comme H2o ou dernièrement Les Quatre Saisons ?
H2o a été un projet sur l’eau avec des coulées, toujours en référence à la nature. Celui des Quatre Saisons a pour thème central les instruments de la création. Le travail en série me permet de partir sur une voie d’exploration et d’en trouver un développement intéressant. C’est avec cette façon de travailler que j’avance. Je pars un mois, un mois et demi et je bosse à fond sur quelque chose qui donne naissance à une nouvelle série, une thématique que je peux approcher différemment.
Quelles sont les orientations récentes de ton travail ?
Actuellement, je suis passé à un travail de drapé. C’est une chose rarement exploitée, si ce n’est le côté académique. Les toiles sont vrillées sur elles‐mêmes, pliées et présentent des zones contrastées. Il y a généralement dans le tableau ce qu’on dit être le châssis et la toile ; je veux sortir de tout cela. Je préfère entrer dans une autre dimension, toujours en rapport avec la nature. Que ce soit des bâches, des tissus, des toiles de tente utilisées par l’armée, je veux faire évoluer ma vision sans cesse et en toute liberté. Il y a dans certaines toiles une idée de «révolution». Ce n’est pas courant d’être confronté à des toiles présentées comme cela. Il arrive un moment où l’on ne fait plus que ce que l’on a envie de faire. On se fout des préjugés et des bien‐pensants. Mon orientation principale, c’est de faire ce que j’aime et de faire ce que j’ai envie de réaliser.
Te réfères‐tu à des artistes connus du monde de l’art ou bien encore à un mouvement artistique ?
L’inspiration, je la trouve avant tout dans la nature, sous mes châtaigniers. Il est probable que certaines de mes toiles puissent faire penser au travail d’Ansselm Kieffer par exemple mais c’est du pur hasard. Ma référence de base est notre environnement. Les mouvements artistiques ne me font ni chaud ni froid. Ce n’est qu’en travaillant et en persévérant qu’on y arrive, pas en s’inspirant de ce que font les autres.
On peut se rendre compte au premier coup d’œil que tes projets sont toujours des projets d’envergure. Ce sont des challenges que tu relèves seul ?
Etre entouré de gens avec qui on se sent bien est primordial. Qu’ils soient compétents et qu’ils développent derrière moi, c’est un atout supplémentaire, c’est sûr. Un artiste ne peut pas tout faire comme être sur le terrain des expositions et à son atelier… J’ai la chance de travailler avec un petit groupe d’amis depuis plusieurs années. Et puis, comme je fais du monumental, je ne peux pas manipuler seul des toiles d’aussi grandes dimensions. Le monumental, pour moi, c’est la vie. La vie, c’est aussi l’amitié.
Biennale de Venise, Centre Culturel Français à Milan, Siège des Nations Unies, etc… les expositions s’enchaînent à un rythme effréné ?
Oui et ça ne s’arrête pas. Entre la préparation des toiles et les expositions, il y a un turn‐over de fou ! La crise n’a épargné personne mais ça repart. De plus, je ne travaille pas à la commande et je n’aime pas travailler dans l’urgence. A un certain âge, j’essaie de rester aussi très libre dans mes choix par rapport à beaucoup de choses. C’est important de ne pas être dépendant d’un système et je n’ai personne qui me dit d’exposer ou de ne pas le faire. Certains exposent pour l’argent, d’autres pour la démarche.
Les projets à venir ?
Il y en a un certain nombre et il faut du temps. Parmi la programmation des prochaines expositions, il y a celle qui se tiendra dans quelques semaines, du 17 mai au 14 juin, à Paris, à la Galerie Nicolas Deman. Mais d’ici quelques jours déjà, je repars à la Garde Freinet, dans ma bergerie pour entamer la création d’autres toiles. Après Pâques, c’est la bonne période. Je vis au rythme des saisons…